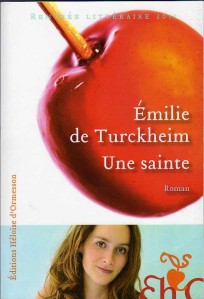 Émilie de Turckheim est l’auteure de six romans, dont trois parus aux Éditions Héloïse d’Ormesson (Le Joli Mois de mai, 2010 ; Héloïse est chauve, 2012 ; Une Sainte, 2013). Elle a également publié chez Naïve un joli petit récit autobiographique sur son expérience de modèle vivant pour peintres et sculpteurs : La Femme à modeler (2012).
Émilie de Turckheim est l’auteure de six romans, dont trois parus aux Éditions Héloïse d’Ormesson (Le Joli Mois de mai, 2010 ; Héloïse est chauve, 2012 ; Une Sainte, 2013). Elle a également publié chez Naïve un joli petit récit autobiographique sur son expérience de modèle vivant pour peintres et sculpteurs : La Femme à modeler (2012).
Je l’ai rencontrée lors de sa venue au Salon du livre de Paris grâce aux Nouveaux Talents, l’initiative de mécénat de la fondation Bouygues Telecom qui a à cœur d’accompagner les écrivains de demain.
La première partie de l’entretien est disponible [ici].
Vous avez écrit sur votre expérience de visiteuse de prison dans Une Sainte. Comment est-ce que vous tissez cette expérience réelle à la fiction, comment travaillez-vous cette matière ?
Avant de le faire, je pensais que ça ne changeait absolument rien, que c’était très abstrait ces frontières entre roman, texte autofictionnel ou autobiographique. Je pensais que dans tous les cas, on faisait la même chose de façon cachée : parler du monde qu’on voit, de soi, de son histoire, de son expérience… En écrivant ce texte qui me touche de très près (quand je l’ai écrit, cela faisait dix ans déjà que j’étais visiteuse), je me suis rendu compte que cela me posait un problème : sous prétexte que c’est tiré d’éléments vécus, j’ai l’impression qu’il faut que ça soit absolument vrai, que je n’ai pas le droit de modifier quoi que ce soit, même pas la couleur des yeux du détenu que je rencontre. Alors que quand je suis dans l’absolu liberté de la fiction romanesque, tout est permis, même quand je parle de choses très intimes qui sont finalement tout aussi réelles que cette expérience vécue. J’ai plutôt vécu cela comme frein. J’ai donc choisi cette forme idéalisée, presque du conte pour enfants, avec ce ton circulaire quasiment biblique pour mettre à distance ce qui me paraissait très étrange, c’est-à-dire la vérité de ma vie qui d’un seul coup n’avait plus rien à faire dans un livre. Tous ces détails qui normalement fleurissent de façon totalement impromptue, je devais au contraire les chercher comme dans des tiroirs en moi. C’est plus besogneux, j’avais la sensation de quelque chose de moins totalement libre.
À la rentrée littéraire prochaine, je publie mon journal de grossesse. À aucun moment il ne s’agit d’un roman. Dans ce cas-là, je me suis sentie beaucoup plus à l’aise parce que j’avais l’impression qu’il n’y avait absolument rien à changer. Tout était dicible, tout était pertinent puisque c’était autobiographique. Dans un roman qui s’inspire de mon histoire personnelle, c’est plus casse-gueule. Parce que j’ai un problème avec la vérité des détails. Je suis très attachée au sens des détails. Si je me mets à mentir, à remplacer un détail par un autre, même s’il me paraît plus vrai ou plus pertinent pour mon roman, j’ai un sentiment de malaise. Par exemple, dans Une Sainte, imaginons qu’un détenu dont je parle très évidemment lise — ce qui n’arrivera jamais — ce roman et se reconnaisse, qu’il reconnaisse la moitié des choses et pas l’autre moitié. Je me demande si la moitié inventée n’entache pas la moitié réelle. Je me demande si on peut mélanger à ce point les choses qui sont vraiment arrivées et les choses qui sortent de son esprit sans tout pervertir. Je n’ai pas vraiment de réponse à cette question, mais c’était très intéressant de se la poser avec justement un texte qui était à la limite de l’autobiographie — sur certains aspects bien sûr, je n’ai pas d’ailes qui poussent dans le dos et je n’ai jamais aidé quelqu’un à s’évader de prison ! Mais quand même, intégrer des lieux, des conversations, des personnages qui existent vraiment dans la vie, c’est le bordel.
Dans Une Sainte, vous écrivez : « Finalement, il n’y a pas que le mensonge et la vérité, il y a la façon de raconter ». C’est ça, pour vous, la littérature ?
C’est sûr, oui ! C’est même troublant de pouvoir tout faire passer, de pouvoir avoir de l’empathie pour n’importe qui, d’entrer dans l’esprit de n’importe quel personnage et comprendre ses motivations, ses amours, sa violence, sa monstruosité. Si on pousse le raisonnement jusqu’au bout, c’est mettre à bas la question de la justice : il n’est plus question de bien ou de mal, tout devient une question de perspective. Ça touche à des questions très profondes sur la construction de nos sociétés. Est-ce que si on avait tous un regard extraordinairement affuté d’auteur, on serait dans une incapacité à vivre parce qu’il n’y aurait que des histoires et que toutes les histoires sont légitimes ? Alors évidemment, il n’y aurait plus de tribunaux, il n’y aurait plus rien. Et sûrement plus de prisons.
Vous écrivez aussi : « Les noms paraissent normaux quand ils sont portés, mais aussitôt qu’inventés pour un hors-la-loi ou pour une histoire, ils sonnent faux. Comment, demandèrent les championnes, font les faiseurs de romans pour choisir les noms ? Peut-être est-ce comme de nommer un nouveau-né. Parfois, fit remarquer Dimitri, les personnages de romans ne portent pas de nom ; c’est le cas des personnages très secondaires gravitant sans gravité autour de l’intrigue ». J’ai trouvé ça très drôle, justement parce que le personnage principal n’a pas de prénom. Ça rejoint ce qu’on disait tout à l’heure à propos de ce jeu avec les codes du roman.
Oui, c’est un jeu avec les codes. Là, en l’occurrence, les joueuses de curling sont vexées parce qu’elles réalisent qu’elles n’ont pas de nom et elles ne prennent pas très bien cette remarque, comme quoi elles sont des personnages très secondaires. Mais c’est comme dans la vie où on ne connaît le nom de famille, le prénom et les trois autres derrière que des gens qui nous sont très proches. Plus on s’éloigne, moins les gens ont un nom, et on finit avec presque rien pour les décrire. Le roman, c’est faire le chemin inverse.
La question des prénoms m’amuse toujours. Parce que quand j’écris, les prénoms me tombent sur la tête. Les personnages écopent d’un prénom et au bout du compte, je me demande : « Est-ce que je les ai baptisés ? Est-ce que c’est dû à une question ridicule de sonorité, parce que je trouve ça joli ? Est-ce que j’aurais appelé mon enfant comme ça ? Est-ce qu’à l’inverse, c’est une vengeance, un prénom mal connoté pour moi ? » Ce pouvoir de carton-pâte m’amuse, parce que tout cela, ce ne sont que des histoires. Dans la vie réelle, la question de nommer un enfant, choisir le nom que va porter une personne toute sa vie prend une importance immense. Je me souviens, quand j’attendais mes enfants, je trouvais même cela très enfermant : il y a quelque chose de tellement spécifique dans un prénom, c’est tellement intime, ça décrit tellement quelque chose de soi qu’il vaudrait peut-être mieux que ce soit l’enfant, une fois qu’il se connaîtra bien, qui choisisse à la majorité son prénom. Dans les romans, ça m’amuse de décider du visage des gens, de leur façon de parler, des prénoms… Il faut tirer les ficelles, tout le temps.
Qu’est-ce que vous lisez en ce moment ? Et quels ouvrages recommanderiez-vous aux apprentis écrivains ?
En ce moment, je lis Karoo de Steve Tesich (Monsieur Toussaint Louverture). Alors sur ces questions de « comment on raconte une histoire », ça se pose là ! Ça parle d’un homme qui est script-doctor au cinéma. Lui, son métier, c’est de réparer les histoires. C’est une énorme métaphore du travail d’écrivain. Et s’il n’a pas encore été lu, je recommande évidemment Malcom Lowry, Au-dessous du volcan (disponible chez Folio dans une traduction de Stephen Spriel), commencez par ça. Le problème, c’est qu’à chaque fois qu’on me demande de recommander des romans, je cite toujours des romans américains. Donc je vais essayer de recommander des romans français… Un roman que j’ai adoré cette année et qu’on peut encore trouver en grand format, c’est Le Bleu des abeilles de Laura Alcoba (Gallimard). Ça raconte l’histoire d’une petite fille qui part d’Argentine pour fuir la dictature et qui arrive à Paris avec tout ce que ça implique de rêves. Elle se retrouve au Blanc Ménil dans une cité HLM qui ne ressemble pas du tout à ses rêves. J’ai trouvé ça très beau sur la question du langage, la façon dont on s’approprie une langue, une littérature et un pays. Ce roman m’a particulièrement touchée parce qu’il nous dit que l’écriture est un lieu, un pays. J’ai toujours eu cette sensation-là, qu’écrire, ce n’est pas une opération de l’esprit, c’est très peu intellectuel, c’est le corps qui est dans l’écriture et on évolue dans l’écriture, dans la littérature comme dans un pays qui nous est familier.





